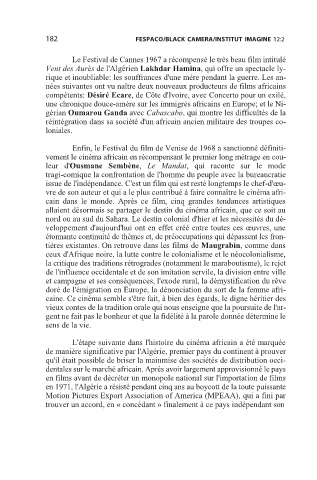Page 191 - Livre2_NC
P. 191
182 FESPACO/BLACK CAMERA/INSTITUT IMAGINE 12:2
Le Festival de Cannes 1967 a récompensé le très beau film intitulé
Vent des Aurès de l'Algérien Lakhdar Hamina, qui offre un spectacle ly-
rique et inoubliable: les souffrances d'une mère pendant la guerre. Les an-
nées suivantes ont vu naître deux nouveaux producteurs de films africains
compétents: Désiré Ecare, de Côte d'Ivoire, avec Concerto pour un exilé,
une chronique douce-amère sur les immigrés africains en Europe; et le Ni-
gérian Oumarou Ganda avec Cabascabo, qui montre les difficultés de la
réintégration dans sa société d'un africain ancien militaire des troupes co-
loniales.
Enfin, le Festival du film de Venise de 1968 a sanctionné définiti-
vement le cinéma africain en récompensant le premier long métrage en cou-
leur d'Ousmane Sembène, Le Mandat, qui raconte sur le mode
tragi-comique la confrontation de l'homme du peuple avec la bureaucratie
issue de l'indépendance. C'est un film qui est resté longtemps le chef-d'œu-
vre de son auteur et qui a le plus contribué à faire connaître le cinéma afri-
cain dans le monde. Après ce film, cinq grandes tendances artistiques
allaient désormais se partager le destin du cinéma africain, que ce soit au
nord ou au sud du Sahara. Le destin colonial d'hier et les nécessités du dé-
veloppement d'aujourd'hui ont en effet créé entre toutes ces œuvres, une
étonnante continuité de thèmes et, de préoccupations qui dépassent les fron-
tières existantes. On retrouve dans les films de Maugrabin, comme dans
ceux d'Afrique noire, la lutte contre le colonialisme et le néocolonialisme,
la critique des traditions rétrogrades (notamment le maraboutisme), le rejet
de l'influence occidentale et de son imitation servile, la division entre ville
et campagne et ses conséquences, l'exode rural, la démystification du rêve
doré de l'émigration en Europe, la dénonciation du sort de la femme afri-
caine. Ce cinéma semble s'être fait, à bien des égards, le digne héritier des
vieux contes de la tradition orale qui nous enseigne que la poursuite de l'ar-
gent ne fait pas le bonheur et que la fidélité à la parole donnée détermine le
sens de la vie.
L'étape suivante dans l'histoire du cinéma africain a été marquée
de manière significative par l'Algérie, premier pays du continent à prouver
qu'il était possible de briser la mainmise des sociétés de distribution occi-
dentales sur le marché africain. Après avoir largement approvisionné le pays
en films avant de décréter un monopole national sur l'importation de films
en 1971, l'Algérie a résisté pendant cinq ans au boycott de la toute puissante
Motion Pictures Export Association of America (MPEAA), qui a fini par
trouver un accord, en « concédant » finalement à ce pays indépendant son