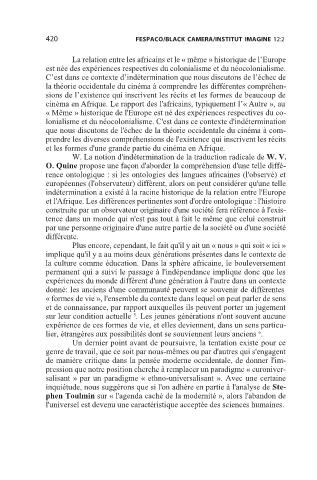Page 429 - Livre2_NC
P. 429
420 FESPACO/BLACK CAMERA/INSTITUT IMAGINE 12:2
La relation entre les africains et le « même » historique de l’Europe
est née des expériences respectives du colonialisme et du néocolonialisme.
C’est dans ce contexte d’indétermination que nous discutons de l’échec de
la théorie occidentale du cinéma à comprendre les différentes compréhen-
sions de l’existence qui inscrivent les récits et les formes de beaucoup de
cinéma en Afrique. Le rapport des l'africains, typiquement l’« Autre », au
« Même » historique de l'Europe est né des expériences respectives du co-
lonialisme et du néocolonialisme. C'est dans ce contexte d'indétermination
que nous discutons de l'échec de la théorie occidentale du cinéma à com-
prendre les diverses compréhensions de l'existence qui inscrivent les récits
et les formes d'une grande partie du cinéma en Afrique.
W. La notion d'indétermination de la traduction radicale de W. V.
O. Quine propose une façon d'aborder la compréhension d'une telle diffé-
rence ontologique : si les ontologies des langues africaines (l'observé) et
européennes (l'observateur) diffèrent, alors on peut considérer qu'une telle
indétermination a existé à la racine historique de la relation entre l'Europe
et l'Afrique. Les différences pertinentes sont d'ordre ontologique : l'histoire
construite par un observateur originaire d'une société fera référence à l'exis-
tence dans un monde qui n'est pas tout à fait le même que celui construit
par une personne originaire d'une autre partie de la société ou d'une société
différente.
Plus encore, cependant, le fait qu'il y ait un « nous » qui soit « ici »
implique qu'il y a au moins deux générations présentes dans le contexte de
la culture comme éducation. Dans la sphère africaine, le bouleversement
permanent qui a suivi le passage à l'indépendance implique donc que les
expériences du monde diffèrent d'une génération à l'autre dans un contexte
donné: les anciens d'une communauté peuvent se souvenir de différentes
« formes de vie », l'ensemble du contexte dans lequel on peut parler de sens
et de connaissance, par rapport auxquelles ils peuvent porter un jugement
sur leur condition actuelle . Les jeunes générations n'ont souvent aucune
5
expérience de ces formes de vie, et elles deviennent, dans un sens particu-
lier, étrangères aux possibilités dont se souviennent leurs anciens .
6
Un dernier point avant de poursuivre, la tentation existe pour ce
genre de travail, que ce soit par nous-mêmes ou par d'autres qui s'engagent
de manière critique dans la pensée moderne occidentale, de donner l'im-
pression que notre position cherche à remplacer un paradigme « euroniver-
salisant » par un paradigme « ethno-universalisant ». Avec une certaine
inquiétude, nous suggérons que si l'on adhère en partie à l'analyse de Ste-
phen Toulmin sur « l'agenda caché de la modernité », alors l'abandon de
l'universel est devenu une caractéristique acceptée des sciences humaines.