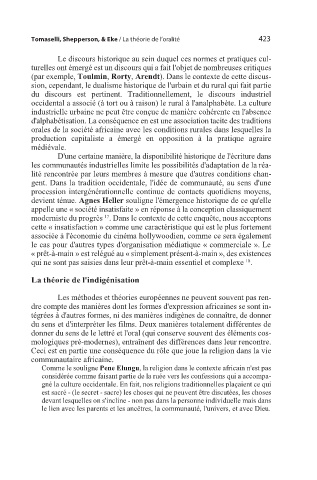Page 432 - Livre2_NC
P. 432
Tomaselli, Shepperson, & Eke / La théorie de l’oralité 423
Le discours historique au sein duquel ces normes et pratiques cul-
turelles ont émergé est un discours qui a fait l'objet de nombreuses critiques
(par exemple, Toulmin, Rorty, Arendt). Dans le contexte de cette discus-
sion, cependant, le dualisme historique de l'urbain et du rural qui fait partie
du discours est pertinent. Traditionnellement, le discours industriel
occidental a associé (à tort ou à raison) le rural à l'analphabète. La culture
industrielle urbaine ne peut être conçue de manière cohérente en l'absence
d'alphabétisation. La conséquence en est une association tacite des traditions
orales de la société africaine avec les conditions rurales dans lesquelles la
production capitaliste a émergé en opposition à la pratique agraire
médiévale.
D'une certaine manière, la disponibilité historique de l'écriture dans
les communautés industrielles limite les possibilités d'adaptation de la réa-
lité rencontrée par leurs membres à mesure que d'autres conditions chan-
gent. Dans la tradition occidentale, l'idée de communauté, au sens d'une
procession intergénérationnelle continue de contacts quotidiens moyens,
devient ténue. Agnes Heller souligne l'émergence historique de ce qu'elle
appelle une « société insatisfaite » en réponse à la conception classiquement
moderniste du progrès . Dans le contexte de cette enquête, nous acceptons
17
cette « insatisfaction » comme une caractéristique qui est le plus fortement
associée à l'économie du cinéma hollywoodien, comme ce sera également
le cas pour d'autres types d'organisation médiatique « commerciale ». Le
« prêt-à-main » est relégué au « simplement présent-à-main », des existences
qui ne sont pas saisies dans leur prêt-à-main essentiel et complexe .
18
La théorie de l'indigénisation
Les méthodes et théories européennes ne peuvent souvent pas ren-
dre compte des manières dont les formes d'expression africaines se sont in-
tégrées à d'autres formes, ni des manières indigènes de connaître, de donner
du sens et d'interpréter les films. Deux manières totalement différentes de
donner du sens de le lettré et l'oral (qui conserve souvent des éléments cos-
mologiques pré-modernes), entraînent des différences dans leur rencontre.
Ceci est en partie une conséquence du rôle que joue la religion dans la vie
communautaire africaine.
Comme le souligne Pene Elungu, la religion dans le contexte africain n'est pas
considérée comme faisant partie de la ruée vers les confessions qui a accompa-
gné la culture occidentale. En fait, nos religions traditionnelles plaçaient ce qui
est sacré - (le secret - sacre) les choses qui ne peuvent être discutées, les choses
devant lesquelles on s'incline - non pas dans la personne individuelle mais dans
le lien avec les parents et les ancêtres, la communauté, l'univers, et avec Dieu.