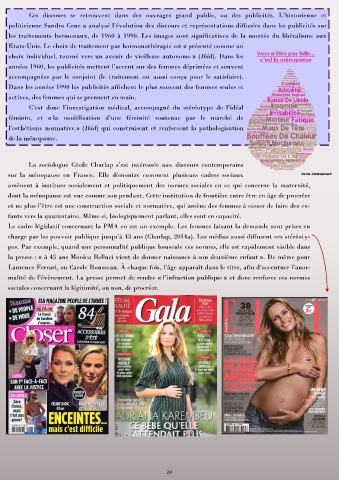Page 29 - C:\Users\Pauline\Documents\Flip PDF Professional\Composition1\
P. 29
Ces discours se retrouvent dans des ouvrages grand public, ou des publicités. L’historienne et
politicienne Sandra Cone a analysé l’évolution des discours et représentations diffusées dans les publicités sur
les traitements hormonaux, de 1960 à 1990. Les images sont significatives de la montée du libéralisme aux
Etats-Unis. Le choix de traitement par hormonothérapie est « présenté comme un
choix individuel, tourné vers un avenir de vieillesse autonome » (Ibid). Dans les
années 1960, les publicités mettent l’accent sur des femmes déprimées et souvent
accompagnées par le conjoint (le traitement est aussi conçu pour le satisfaire).
Dans les années 1990 les publicités affichent le plus souvent des femmes seules et
actives, des femmes qui se prennent en main.
C’est donc l’investigation médical, accompagné du stéréotype de l’idéal
féminin, et « la modélisation d’une féminité soutenue par le marché de
l’esthétisme normative » (Ibid) qui construisent et renforcent la pathologisation
de la ménopause.
La sociologue Cécile Charlap s’est intéressée aux discours contemporains
sur la ménopause en France. Elle démontre comment plusieurs cadres sociaux
amènent à instituer socialement et politiquement des normes sociales en ce qui concerne la maternité,
dont la ménopause est vue comme son pendant. Cette institution de frontière entre être en âge de procréer
et ne plus l’être est une construction sociale et normative, qui amène des femmes à cesser de faire des en-
fants vers la quarantaine. Même si, biologiquement parlant, elles sont en capacité.
Le cadre législatif concernant la PMA en est un exemple. Les femmes faisant la demande sont prises en
charge par les pouvoir publique jusqu’à 43 ans (Charlap, 2014a). Les médias aussi diffusent ces stéréoty-
pes. Par exemple, quand une personnalité publique bouscule ces normes, elle est rapidement visible dans
la presse : « à 45 ans Monica Belluci vient de donner naissance à son deuxième enfant ». De même pour
Laurence Ferrari, ou Carole Rousseau. À chaque fois, l’âge apparaît dans le titre, afin d’accentuer l’anor-
malité de l’évènement. La presse permet de rendre « l’infraction publique » et donc renforce ces normes
sociales concernant la légitimité, ou non, de procréer.
29