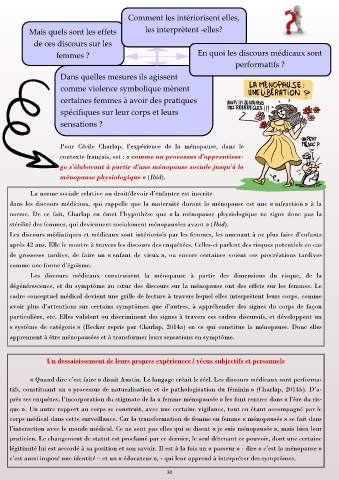Page 30 - C:\Users\Pauline\Documents\Flip PDF Professional\Composition1\
P. 30
Comment les intériorisent elles,
Mais quels sont les effets les interprètent -elles?
de ces discours sur les
En quoi les discours médicaux sont
femmes ?
performatifs ?
Dans quelles mesures ils agissent
comme violence symbolique mènent
certaines femmes à avoir des pratiques
spécifiques sur leur corps et leurs
sensations ?
Pour Cécile Charlap, l’expérience de la ménopause, dans le
contexte français, est : « comme un processus d’apprentissa-
ge s’élaborant à partir d’une ménopause sociale jusqu’à la
ménopause physiologique » (Ibid).
La norme sociale relative au droit/devoir d’enfanter est inscrite
dans les discours médicaux, qui rappelle que la maternité durant la ménopause est une « infraction » à la
norme. De ce fait, Charlap en émet l’hypothèse que « la ménopause physiologique ne signe donc pas la
stérilité des femmes, qui deviennent socialement ménopausées avant » (Ibid).
Les discours médiatiques et médicaux sont intériorisés par les femmes, les amenant à ne plus faire d’enfants
après 42 ans. Elle le montre à travers les discours des enquêtées. Celles-ci parlent des risques potentiels en cas
de grossesse tardive, de faire un « enfant de vieux », ou encore certaines voient ces procréations tardives
comme une forme d’égoïsme.
Les discours médicaux construisent la ménopause à partir des dimensions du risque, de la
dégénérescence, et du symptôme au cœur des discours sur la ménopause ont des effets sur les femmes. Le
cadre conceptuel médical devient une grille de lecture à travers lequel elles interprètent leurs corps, comme
avoir plus d’attentions sur certains symptômes que d’autres, à appréhender des signes du corps de façon
particulière, etc. Elles valident ou discriminent des signes à travers ces cadres discursifs, et développent un
« système de catégorie » (Becker repris par Charlap, 2014a) en ce qui constitue la ménopause. Donc elles
apprennent à être ménopausées et à transformer leurs sensations en symptôme.
Un dessaisissement de leurs propres expériences / vécus subjectifs et personnels
« Quand dire c’est faire » disait Austin. Le langage créait le réel. Les discours médicaux sont performa-
tifs, constituant un « processus de naturalisation et de pathologisation du féminin » (Charlap, 2014b). D’a-
près ses enquêtes, l’incorporation du stigmate de la « femme ménopausée » les font rentrer dans « l’ère du ris-
que ». Un autre rapport au corps se construit, avec une certaine vigilance, tout en étant accompagné par le
corps médical dans cette surveillance. Car la transformation de femme en femme « ménopausée » se fait dans
l’interaction avec le monde médical. Ce ne sont pas elles qui se disent « je suis ménopausée », mais bien leur
praticien. Le changement de statut est proclamé par ce dernier, le seul détenant ce pouvoir, dont une certaine
légitimité lui est accordé à sa position et son savoir. Il est à la fois un « passeur » - dire « c’est la ménopause »
c’est aussi imposé une identité – et un « éducateur », - qui leur apprend à interpréter des symptômes.
30