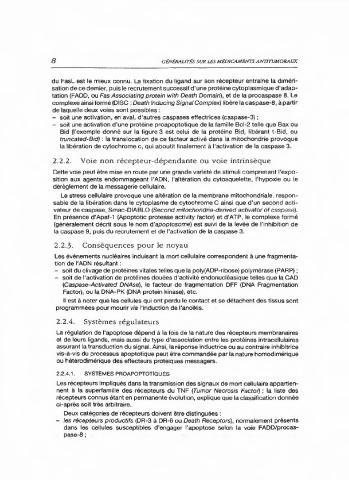Page 50 - Traité de chimie thérapeutique 6 Médicaments antitumoraux
P. 50
8 GÉNERALITES SUR LES MÉDICAMENTS ANTTTUMORAUX
du FasL est le mieux connu. La fixation du ligand sur son récepteur entraine la diméri-
sation de ce dernier, puis le recrutement successif d'une protéine cytoplasmique d'adap-
tation (FADO, ou Fas Associating protein with Death Domain), et de la procaspase 8. Le
complexe ainsi formé (DISC : Death Inducing Signal Complex) libère la caspase-8, à partir
de laquelle deux voies sont possibles :
- soit une activation, en aval, d'autres caspases effectrices (caspase-3);
- soit une activation d'une protéine proapoptotique de la famille Bcl-2 telle que Bax ou
Bid (l'exemple donné sur la figure 3 est celui de la protéine Bid, libérant t-Bid, ou
truncated-Bid) : la translocation de ce facteur activé dans la mitochondrie provoque
la libération de cytochrome c, qui aboutit finalement à l'activation de la caspase 3.
2.2.2. Voie non récepteur-dépendante ou voie intrinsèque
Cette voie peut être mise en route par une grande variété de stimuli comprenant l'expo-
sition aux agents endommageant l'ADN, l'altération du cytosquelette, l'hypoxie ou le
dérèglement de la messagerie cellulaire.
Le stress cellulaire provoque une altération de la membrane mitochondriale, respon-
sable de la libération dans le cytoplasme de cytochrome C ainsi que d'un second acti-
vateur de caspase, Smac-DIABLO (Second mitochondria-derived activator of caspase).
En présence d'Apaf-1 (Apoptotic protease activity factor) et d'ATP, le complexe formé
(généralement décrit sous le nom d'apoptosome) est suivi de la levée de l'inhibition de
la caspase 9, puis du recrutement et de l'activation de la caspase 3.
2.2.3. Conséquences pour le noyau
Les événements nucléaires induisant la mort cellulaire correspondent à une fragmenta-
tion de l'ADN résultant:
- soit du clivage de protéines vitales telles que la poly(ADP-ribose) polymérase (PARP) ;
- soit de l'activation de protéines douées d'activité endonucléasique telles que la CAO
(Caspase-Activated DNAse), le facteur de fragmentation OFF (DNA Fragmentation
Factor), ou la DNA-PK (DNA protein kinase), etc.
Il est à noter que les cellules qui ont perdu le contact et se détachent des tissus sont
programmées pour mourir via l'induction de l'anoïkis.
2.2.4. Systèmes régulateurs
La régulation de l'apoptose dépend à la fois de la nature des récepteurs membranaires
et de leurs ligands, mais aussi du type d'association entre les protéines intracellulaires
assurant la transduction du signal. Ainsi, la réponse inductrice ou au contraire inhibitrice
vis-à-vis du processus apoptotique peut être commandée par la nature homodimérique
ou hétérodimérique des effecteurs protéiques messagers.
2.2.4.1. SYSTÈMES PROAPOPTOTIQUES
Les récepteurs impliqués dans la transmission des signaux de mort cellulaire appartien-
nent à la superfamille des récepteurs du TNF (Tumor Necrosis Factor) ; la liste des
récepteurs connus étant en permanente évolution, explique que la classification donnée
ci-après soit très arbitraire.
Deux catégories de récepteurs doivent être distinguées :
- les récepteurs productifs (DR-3 à DR-6 ou Death Receptors), normalement présents
dans les cellules susceptibles d'engager l'apoptose selon la voie FADD/procas-
pase-8 ;