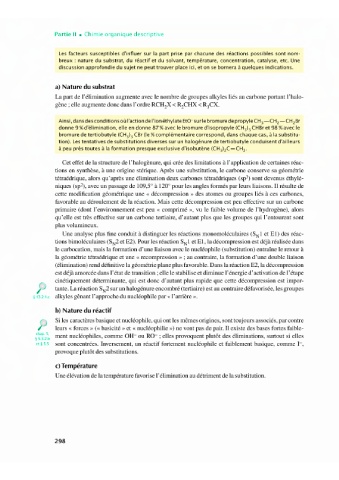Page 319 - Chimie organique - cours de Pau 2- Brigitte Jamart
P. 319
Partie Il ■ Chimie organique descriptive
Les facteurs susceptibles d'influer sur la part prise par chacune des réactions possibles sont nom-
breux : nature du substrat, du réactif et du solvant, température, concentration, catalyse, etc. Une
discussion approfondie du sujet ne peut trouver place ici, et on se bornera à quelques indications.
a) Nature du substrat
La part del' élimination augmente avec le nombre de groupes alkyles liés au carbone portant l'halo-
gène ; elle augmente donc dans l'ordre RCH,X < R,CHX <R,CX.
Ainsi, dans des conditions oùl'action de l'ion éthylate EtO surlebromure depropyle CH,CH,CH,Br
donne 9 % d'élimination, elle en donne 87% avec le bromure d'isopropyle (CH,), CHBr et 98 %avec le
bromure de tertiobutyle (CH,), CBr (le% complémentaire correspond, dans chaque cas, à la substitu-
tion). Les tentatives de substitutions diverses sur un halogénure de tertiobutyle conduisent d'ailleurs
à peu près toutes à la formation presque exclusive d'isobutène (CH,)C=CH,.
Cet effet de la structure de l'halogènure, qui crée des limitations à l'application de certaines réac-
tions en synthèse, à une origine stérique. Après une substitution, le carbone conserve sa géométrie
3
tétraédrique, alors qu'après une élimination deux carbones tétraédriques (sp ) sont devenus éthylé-
niques (sp), avec un passage de 109,5° à 120° pour les angles formés par leurs liaisons. Il résulte de
cette modification géométrique une « décompression » des atomes ou groupes liés à ces carbones,
favorable au déroulement de la réaction. Mais cette décompression est peu effective sur un carbone
primaire (dont l'environnement est peu « comprimé », vu le faible volume de l'hydrogène), alors
qu'elle est très effective sur un carbone tertiaire, d'autant plus que les groupes qui l'entourent sont
plus volumineux.
Une analyse plus fine conduit à distinguer les réactions monomoléculaires (SNI et El) des réac-
tions bimoléculaires (S,2 et E2). Pour les réaction S,1 et El, la décompression est déjà réalisée dans
le carbocation, mais la formation d'une liaison avec le nucléophile (substitution) entraîne le retour à
la géométrie tétraédrique et une « recompression » ; au contraire, la formation d'une double liaison
(élimination) rend définitive la géométrie plane plus favorable. Dans la réaction E2, la décompression
est déjà amorcée dans l'état de transition ; elle le stabilise et diminue l'énergie d'activation del' étape
cinétiquement déterminante, qui est donc d'autant plus rapide que cette décompression est impor-
2 tante. La réaction S,2 sur un halogénure encombré (tertiaire) est au contraire défavorisée, les groupes
§ 13.2.1.c alkyles gênant l'approche du nucléophile par« l'arrière».
b) Nature du réactif
2 Si les caractères basique et nucléophile, qui ont les mêmes origines, sont toujours associés, par contre
leurs « forces » (« basicité » et « nucléophilie ») ne vont pas de pair. Il existe des bases fortes faible-
chap. 5,
§ 5.3.2.b ment nucléophiles, comme OH- ou RO- ; elles provoquent plutôt des éliminations, surtout si elles
et§ 5.5 sont concentrées. Inversement, un réactif fortement nucléophile et faiblement basique, comme I,
provoque plutôt des substitutions.
c) Température
Une élévation de la température favorise l'élimination au détriment de la substitution.
298