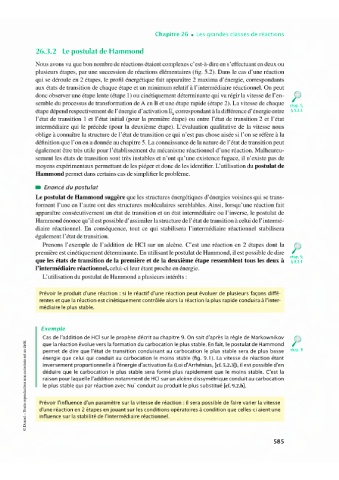Page 606 - Chimie organique - cours de Pau 2- Brigitte Jamart
P. 606
Chapitre 26 ■ Les grandes classes de réactions
26.3.2 Le postulat de Hammond
Nous avons vu que bon nombre de réactions étaient complexes c'est-à-dire en s'effectuant en deux ou
plusieurs étapes, par une succession de réactions élémentaires (fig. 5.2). Dans le cas d'une réaction
qui se déroule en 2 étapes, le profil énergétique fait apparaître 2 maxima d'énergie, correspondants
aux états de transition de chaque étape et un minimum relatif à l'intermédiaire réactionnel. On peut
donc observer une étape lente (étape 1) ou cinétiquement déterminante qui va régir la vitesse del' en- 2
semble du processus de transformation de A en B et une étape rapide (étape 2). La vitesse de chaque
chap. 5,
étape dépend respectivement de l'énergie d'activation E, correspondant à la différence d'énergie entre § 5.2.3
l'état de transition 1 et l'état initial (pour la première étape) ou entre l'état de transition 2 et l'état
intermédiaire qui le précède (pour la deuxième étape). L'évaluation qualitative de la vitesse nous
oblige à connaître la structure del' état de transition ce qui n'est pas chose aisée sil' on se réfère à la
définition quel' on en a donnée au chapitre 5. La connaissance de la nature del' état de transition peut
également être très utile pour l'établissement du mécanisme réactionnel d'une réaction. Malheureu-
sement les états de transition sont très instables et n'ont qu'une existence fugace, il n'existe pas de
moyens expérimentaux permettant de les piéger et donc de les identifier. L'utilisation du postulat de
Hammond permet dans certains cas de simplifier le problème.
Enoncé du postulat
Le postulat de Hammond suggère que les structures énergétiques d'énergies voisines qui se trans-
forment l'une en l'autre ont des structures moléculaires semblables. Ainsi, lorsqu'une réaction fait
apparaître consécutivement un état de transition et un état intermédiaire ou l'inverse, le postulat de
Hammond énonce qu'il est possible d'assimiler la structure del' état de transition à celui de l'intermé-
diaire réactionnel. En conséquence, tout ce qui stabilisera l'intermédiaire réactionnel stabilisera
également l'état de transition.
Prenons l'exemple de l'addition de HCl sur un alcène. C'est une réaction en 2 étapes dont la
première est cinétiquement déterminante. En utilisant le postulat de Hammond, il est possible de dire 2
chap. 9,
que les états de transition de la première et de la deuxième étape ressemblent tous les deux à § 9.2.1
l'intermédiaire réactionnel, celui-ci leur étant proche en énergie.
L'utilisation du postulat de Hammond a plusieurs intérêts :
Prévoir le produit d'une réaction : si le réactif d'une réaction peut évoluer de plusieurs façons diffé-
rentes et que la réaction est cinétiquement contrôlée alors la réaction la plus rapide conduira à l'inter-
médiaire le plus stable.
Exemple
Cas de l'addition de HCI sur le propène décrit au chapitre 9. On sait d'après la règle de Markownikov p
que la réaction évolue vers la formation du carbocation le plus stable. En fait, le postulat de Hammond
permet de dire que l'état de transition conduisant au carbocation le plus stable sera de plus basse chap. 9
énergie que celui qui conduit au carbocation le moins stable (fig. 9.1). La vitesse de réaction étant
inversement proportionnelle à l'énergie d'activation Ea (Loi d'Arrhénius, [cf. 5.2.3]), il est possible d'en
déduire que le carbocation le plus stable sera formé plus rapidement que le moins stable. C'est la
raison pour laquelle l'addition notamment de HCI sur un alcène dissymétrique conduit au carbocation
le plus stable qui par réaction avec Nu conduit au produit le plus substitué [cf. 9.2.b].
Prévoir l'influence d'un paramètre sur la vitesse de réaction: il sera possible de faire varier la vitesse
d'une réaction en 2 étapes enjouant sur les conditions opératoires à condition que celles-ci aient une
influence sur la stabilité de l'intermédiaire réactionnel.
585